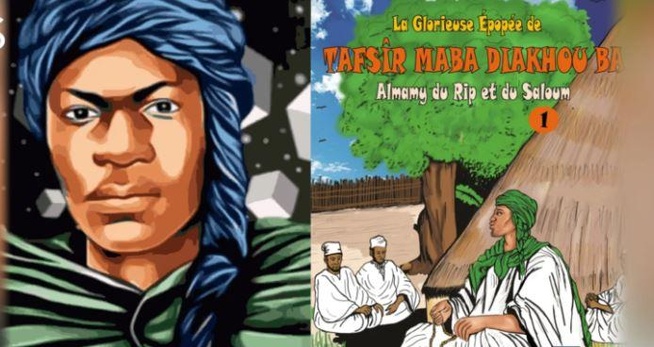De 1861 à 1867, le centre-ouest du Sénégal (le Sine, le Saloum, le Baol, le Diolof et le Cayor) devient le théâtre d’une recomposition politique marquée par des alliances de circonstance, des conflits idéologiques et des stratégies militaires opposant pouvoirs traditionnels, jihad islamique et colonisation européenne.
Les prémices : défaites et reconfigurations militaires (1863–1864)
Après la lourde défaite des troupes coloniales françaises à la bataille de Ngol-Ngol en décembre 1863, suivie de celle infligée à Lat Dior à Loro le 12 janvier 1864, la région est bouleversée. Lat Dior, traqué, réfugié successivement dans le Baol, le Sine, puis le Saloum, trouve finalement asile chez Ma Ba Diakhou Dièye dans le Rip.
Le gouverneur Faidherbe puis Pinet-Laprade intensifient les campagnes d’annexion. Après avoir conquis le Walo et le Cayor, ils soumettent le Sine et le Saloum par la force et la diplomatie coercitive. Traités humiliants, cessions de terres, amendes en bétail et livraisons d’otages s’ensuivent.
Le gouverneur Faidherbe puis Pinet-Laprade intensifient les campagnes d’annexion. Après avoir conquis le Walo et le Cayor, ils soumettent le Sine et le Saloum par la force et la diplomatie coercitive. Traités humiliants, cessions de terres, amendes en bétail et livraisons d’otages s’ensuivent.
Ma Ba Diakhou, entre islam et résistance politique
Originaire du Rip, de mère wolof et de père d’ascendance toucouleur, Ma Ba Diakhou Dièye entreprend à partir de 1861 une vaste campagne d’islamisation et de regroupement politique. Son objectif : une confédération musulmane capable de stopper l’avancée coloniale.
Il fédère autour de lui anciens thiedo, marabouts wolofs et cavaliers du Rip, du Ndiambour, du Diolof, du Baol et du Kadjoor. En 1865, ses troupes, avec Lat Dior à leurs côtés, tentent de prendre le Diolof et traversent Mbacké, provoquant déjà des tensions avec le Sine.
Il fédère autour de lui anciens thiedo, marabouts wolofs et cavaliers du Rip, du Ndiambour, du Diolof, du Baol et du Kadjoor. En 1865, ses troupes, avec Lat Dior à leurs côtés, tentent de prendre le Diolof et traversent Mbacké, provoquant déjà des tensions avec le Sine.
L'expédition francaise et la résistance de Maba (1865-1866)
En réaction, le gouverneur Pinet-Laprade monte une expédition en novembre 1865 : 4000 fantassins, 2000 cavaliers, artillerie et obusiers pour anéantir Maba. Mais, à Paos Koto, les forces de l’Almamy remportent une victoire symbolique. Maba devient alors, aux yeux des colons, “le chef de file de la résistance sénégambienne”.
Il se replie en Gambie en 1866, mais ses talibés continuent d’opérer dans le delta Saloum-Gambie, interceptant armes, marchandises et ravitaillant le Sine.
Il se replie en Gambie en 1866, mais ses talibés continuent d’opérer dans le delta Saloum-Gambie, interceptant armes, marchandises et ravitaillant le Sine.
Avril 1867 : offensive finale de Ma Ba vers le Sine
Le 20 avril 1867, Ma Ba, accompagné de Lat Dior, lance une campagne contre le Sine. Les combats à Thioffatt et Marout montrent une avance initiale des troupes de Maba, mais des renforts mobilisés par le Buur Sine Coumba Ndoffène Famak freinent leur progression.
Le 29 avril, lors d’une réunion du Conseil d’administration de la colonie, la “liquidation” de Maba est décidée : soutien au Buur Sine, alliance militaire, espionnage et concentration de troupes à Diakhao.
Le 29 avril, lors d’une réunion du Conseil d’administration de la colonie, la “liquidation” de Maba est décidée : soutien au Buur Sine, alliance militaire, espionnage et concentration de troupes à Diakhao.
La bataille de Somb (18 juillet 1867)
Le 17 juillet 1867, Ma Ba et Lat Dior pénètrent dans le sud-est du Sine. Le 18 juillet, au marigot de Fandane, près de Somb-Tioutioune, les armées s’affrontent.
Une pluie diluvienne s’abat sur les troupes de l’Almamy. Les poudres sont inutilisables, les munitions détrempées. Malgré les appels de Lat Dior à battre en retraite, Ma Ba refuse, préférant laisser son destin entre les mains de Dieu.
Le Buur Sine, stratège averti, avait mobilisé tous les chefs traditionnels et les guerriers du royaume. Il reçoit en plus l’appui logistique de la colonie et de ses canons. La bataille vire au massacre : plus de 500 talibés sont tués, des centaines de captifs, et Ma Ba tombe au champ d’honneur, enlacé avec Makhoukhédia Ngoné selon la tradition orale.
Une pluie diluvienne s’abat sur les troupes de l’Almamy. Les poudres sont inutilisables, les munitions détrempées. Malgré les appels de Lat Dior à battre en retraite, Ma Ba refuse, préférant laisser son destin entre les mains de Dieu.
Le Buur Sine, stratège averti, avait mobilisé tous les chefs traditionnels et les guerriers du royaume. Il reçoit en plus l’appui logistique de la colonie et de ses canons. La bataille vire au massacre : plus de 500 talibés sont tués, des centaines de captifs, et Ma Ba tombe au champ d’honneur, enlacé avec Makhoukhédia Ngoné selon la tradition orale.
Interprétations multiples de la défaite
Les récits divergent :
• Niokhobaye Diouf, dans Chronique du royaume du Sine, décrit la détermination des troupes sérères, le piège militaire organisé autour de Maba et la loyauté ultime de Coumba Ndoffène.
• Amadou-Bamba Diop, petit-fils de Lat Dior, insiste sur la stratégie militaire du Sine et les efforts de Lat Dior pour sauver Ma Ba.
• Abdou-Boury Ba, descendant de Maba, nuance l’idée d’une trahison de Lat Dior, expliquant qu’il fut contraint par ses proches à se retirer.
• Niokhobaye Diouf, dans Chronique du royaume du Sine, décrit la détermination des troupes sérères, le piège militaire organisé autour de Maba et la loyauté ultime de Coumba Ndoffène.
• Amadou-Bamba Diop, petit-fils de Lat Dior, insiste sur la stratégie militaire du Sine et les efforts de Lat Dior pour sauver Ma Ba.
• Abdou-Boury Ba, descendant de Maba, nuance l’idée d’une trahison de Lat Dior, expliquant qu’il fut contraint par ses proches à se retirer.
Réhabilitation historique de Maba Diakhou
Pendant longtemps, l’historiographie coloniale puis post-indépendante a réduit Maba à un marabout toucouleur en croisade religieuse contre les royaumes traditionnels.
Mais les faits sont clairs :
• Maba était wolofisé, ancré dans les structures sociales sénégambiennes.
• Son armée était essentiellement composée de guerriers wolofs, anciens thiedo et marabouts.
• Son objectif était avant tout politique, visant à fédérer une résistance à l’expansion coloniale et à libérer les royaumes déjà soumis comme le Cayor ou le Baol.
Le royaume du Sine était un verrou stratégique. Sa conquête devait permettre l’accès direct au Cayor et au Diolof. La bataille de Somb ne fut donc ni un simple conflit religieux, ni une guerre de cousinage, mais bien une tentative d’unification politique et militaire sénégambienne brisée par la conjonction d’intérêts entre les royaumes traditionnels et la puissance coloniale.
Mais les faits sont clairs :
• Maba était wolofisé, ancré dans les structures sociales sénégambiennes.
• Son armée était essentiellement composée de guerriers wolofs, anciens thiedo et marabouts.
• Son objectif était avant tout politique, visant à fédérer une résistance à l’expansion coloniale et à libérer les royaumes déjà soumis comme le Cayor ou le Baol.
Le royaume du Sine était un verrou stratégique. Sa conquête devait permettre l’accès direct au Cayor et au Diolof. La bataille de Somb ne fut donc ni un simple conflit religieux, ni une guerre de cousinage, mais bien une tentative d’unification politique et militaire sénégambienne brisée par la conjonction d’intérêts entre les royaumes traditionnels et la puissance coloniale.
La bataille de Somb incarne l’un des derniers grands actes de résistance militaire et politique contre la colonisation française au Sénégal. Elle fut aussi un moment de rupture entre deux visions du pouvoir : celle centralisée d’un jihad de libération dirigé par Ma Ba, et celle décentralisée des royaumes traditionnels alliés aux colons pour préserver leur autonomie.
Aujourd’hui, revisiter la mémoire de Maba Diakhou Dièye, de Coumba Ndoffène et de Lat Dior, c’est aussi comprendre les fondements des dynamiques politiques sénégalaises contemporaines, entre traditions royales, quête de souveraineté et tentatives d’unité.
Diawdine Amadou Bakhaw DIAW,
Président de l’Association Mbootayu Léppiy Wolof
Aujourd’hui, revisiter la mémoire de Maba Diakhou Dièye, de Coumba Ndoffène et de Lat Dior, c’est aussi comprendre les fondements des dynamiques politiques sénégalaises contemporaines, entre traditions royales, quête de souveraineté et tentatives d’unité.
Diawdine Amadou Bakhaw DIAW,
Président de l’Association Mbootayu Léppiy Wolof